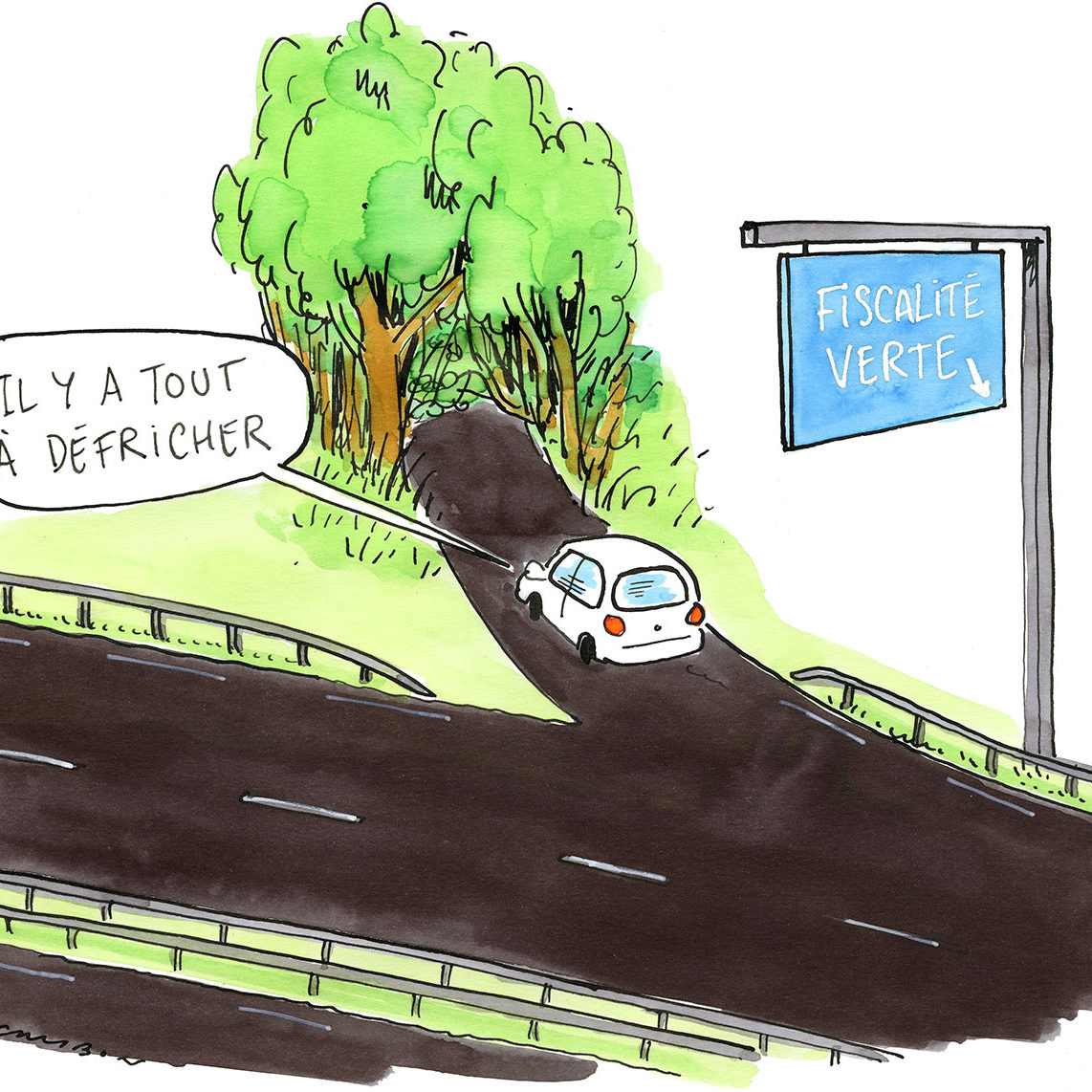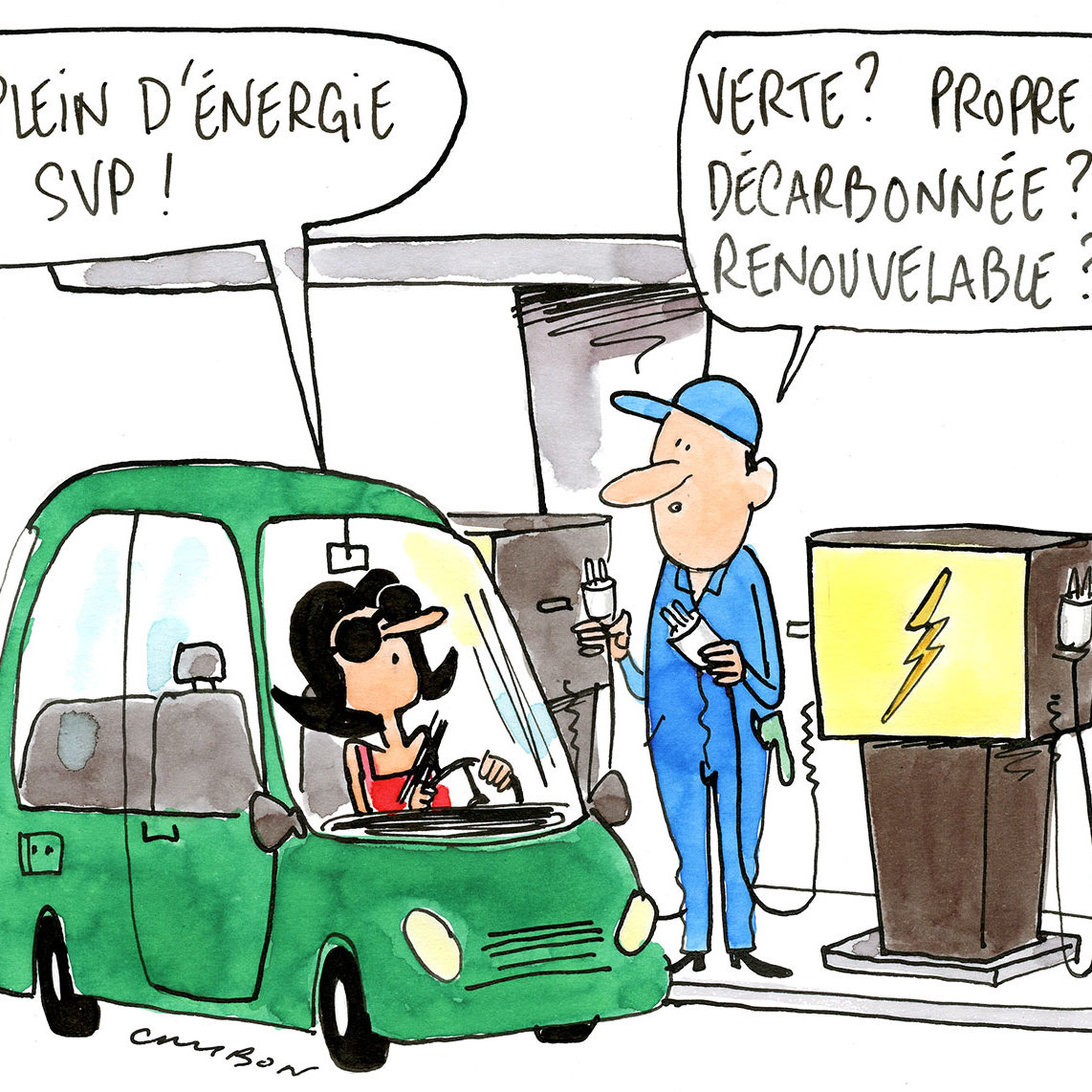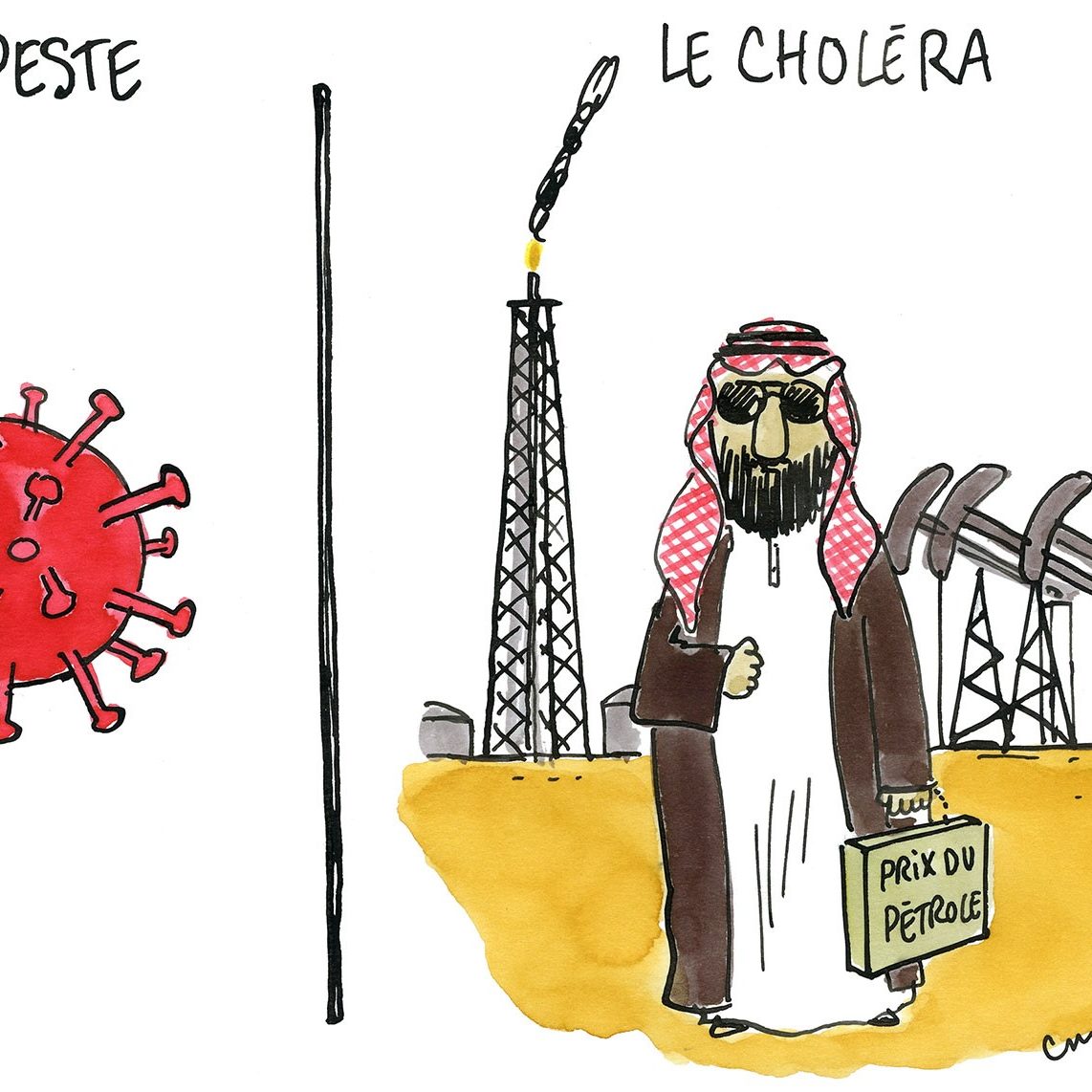La crise sociale et sociétale s’accompagne désormais d’une crise environnementale sans précédent qui témoigne de la non-soutenabilité du modèle de développement des pays industrialisés (rapports du Groupe international d’experts sur le climat (GIEC), rapports du Panel international d’experts sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES)…).
Le rapport annuel Global Risks 2020 (rapport basé sur l’avis de plus de 750 experts) publié par le « World Economic Forum » met en exergue une augmentation des « confrontations économiques » et la « polarisation politique intérieure ». En outre, pour la première fois dans les perspectives à 10 ans de l’enquête, les cinq risques les plus importants en termes de probabilité sont tous environnementaux.
Cette prise de conscience par les entreprises et les décideurs d’un monde en crise s’inscrit dans un contexte de forte interrogation sur la soutenabilité du modèle capitaliste. Déjà en 2014, cinq chercheurs américains, Immanuel Wallerstein, Michael Mann, Randall Collins, Georgi Derluguian, Craig Calhoun, dans leur ouvrage « Le capitalisme a-t-il un avenir ? » s’appuyant sur les sciences sociales et en analysant l’histoire économique du 20ème siècle, arguaient que les limites du « système-monde » capitaliste seraient atteintes dans quelques décennies. Parmi les vecteurs de cette disparition, on notait déjà les catastrophes environnementales et les coûts sociaux des entreprises externalisés vers l’ensemble de la société.
Le rôle sociétal de l’entreprise n’est pas un fait nouveau. Déjà au 17ème siècle, le commerce était considéré comme un instrument de souveraineté extérieure : « le commerce est une guerre d’argent » disait Colbert. Au 21ème siècle, l’entreprise est appelée à jouer un rôle tout aussi fondamental, celui de fantassin d’une guerre pour la justice sociale en partenariat avec les états car sans une telle justice, comme le stipule la déclaration de Philadelphie de 1944, point de paix durable.
Face aux bouleversements actuels de différents ordres, l’entreprise est donc appelée à se refonder : son substrat technique doit s’adapter au changement de paradigme que représente la révolution numérique ; sa philosophie gestionnaire doit intégrer la nécessité d’un profit « vert » pour préserver notre écoumène ; enfin sa vision simplifiée des relations avec son écosystème doit inclure la nécessité d’agir pour le bien commun et au-delà pour la justice sociale.
Société et entreprise : des rendez-vous manqués
Dans l’histoire contemporaine, les rendez-vous manqués entre l’entreprise et la société sont nombreux : traité de Versailles en 1919, déclaration de Philadelphie en 1944, introduction du concept de responsabilité sociale des entreprises dans les années 70, déclarationdu centenaire de l’Organisation internationale du Travail (OIT) en 2019 … En effet, dès le début du 20 ème, le traité de Versailles qui marque la fin de la Première Guerre mondiale stipule clairement le lien entre l’entreprise et la société, la justice sociale et la paix durable.
« Attendu que la Société des Nations a pour but d’établir la paix universelle, et qu’une telle paix ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale ; attendu qu’il existe des conditions de travail impliquant pour un grand nombre de personnes l’injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et l’harmonie universelles sont mises en danger, et attendu qu’il est urgent d’améliorer ces conditions : par exemple, en ce qui concerne la réglementation des heures de travail, la fixation d’une durée maxima de la journée et de la semaine de travail, le recrutement de la main-d’œuvre, la lutte contre le chômage, la garantie d’un salaire assurant des conditions d’existence convenables, la protection des travailleurs contre les maladies générales ou professionnelles et les accidents résultant du travail, la protection des enfants, des adolescents et des femmes, les pensions de vieillesse et d’invalidité, la défense des intérêts des travailleurs occupés à l’étranger, l’affirmation du principe de la liberté syndicale, l’organisation de l’enseignement professionnel et technique et autres mesures analogues ; attendu que la non adoption par une nation quelconque d’un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations désireuses d’améliorer le sort des travailleurs dans leurs propres pays ;… Les hautes parties contractantes, mues par des sentiments de justice et d’humanité aussi bien que par le désir d’assurer une paix mondiale durable… ».
Cette velléité de justice sociale avec des entreprises concourant à l’harmonie des nations s’est quelque peu dissipée au fur et à mesure que le capitalisme gagnait ses lettres de noblesse nonobstant le compromis fordiste qui consistait à proposer des mesures d’accompagnement aux salariés pour leur faire accepter l’organisation scientifique du travail et plus tard, l’avènement de l’assurance chômage dans de nombreux pays.
La persistance des inégalités de revenus dans les pays développés est devenue une réalité et les conséquences en sont alarmantes : mouvement des gilets jaunes en France, manifestations au Chili (pays considéré comme le pays le plus stable d’Amérique Latine), contre la hausse du ticket de métro, mouvement Cinque Stelle en Italie, mouvement Occupy Wall Street aux Etats-Unis en 2011 …
En effet, les dernières données de l’OCDE en 2019 sur la distribution des revenus (IDD)[1] montrent que les inégalités de revenus demeurent à des niveaux records dans de nombreux pays malgré le repli des taux de chômage et l’amélioration des taux d’emploi. La sentence prononcée par l’institution est sans équivoque : « le fait que les bénéfices de la croissance économique n’aient pas été équitablement distribués et que la crise économique n’ait fait que creuser le fossé entre riches et pauvres est une vision largement partagée ». Parallèlement, les entreprises ne sont pas exemptes de reproches quant à la détérioration de l’environnement et au dérèglement climatique. Elles auraient causé à elles seules 71% des émissions mondiales de gaz à effet de serre depuis 1988 selon un rapport de la Carbon Disclosure Project (CDP).
Les exigences de justice sociale et de respect de l’environnement restent pleines et entières malgré la richesse créée ces 50 dernières années par les entreprises. La proclamation de la responsabilité sociale des entreprises dans les années 1970, salutaire malgré les tentatives de « social-washing » ou de « green-washing », n’a pas réussi à réaliser la jonction nécessaire entre les intérêts des entreprises et les défis sociaux, sociétaux et écologiques.
[1] https://www.oecd.org/fr/social/soc/inegalite-et-pauvrete.htm
La nécessité d’une entreprise inclusive dans son objet social et au-delà
La gouvernance des entreprises en s’éloignant du modèle schumpétérien a dérivé depuis plusieurs années jusqu’à ne mettre l’emphase que sur la valeur pour l’actionnaire. Cette focalisation sur le court-terme positionne au second plan les engagements de plus long terme notamment les visées sociales, sociétales et environnementales. Cette priorité donnée aux actionnaires n’est pas une stratégie délibérée mais la conséquence d’un objet social circonscrit aux seuls aspects financiers de la gouvernance.
La refondation en droit de la mission de l’entreprise est donc de mise.
Cette problématique a d’ailleurs été prise à bras le corps par la recherche en gestion, notamment par les professeurs Blanche Segrestin et Armand Hatchuel, de l’école des Mines de Paris. Dans leur ouvrage, La « Société à Objet Social étendu », (Les Presses des Mines, 2015), les auteurs préconisaient déjà plusieurs pistes de réflexion parmi lesquelles :
- Au-delà du profit, remettre l’innovation et le progrès collectif au centre de la mission de l’entreprise.
- Renforcer le contrôle de l’action du dirigeant en créant un collectif incluant les salariés.
- S’inspirer du droit maritime notamment de la règle des « avaries communes » (procédure de répartition des frais et dommages entraînés par des mesures de sauvetage décidées dans l’intérêt commun d’un navire et des marchandises qu’il transporte), afin que, dans l’entreprise, « les effets des décisions prises dans l’intérêt commun » puissent être « assumés en commun ».
- La création d’un nouveau statut d’entreprise à objet social étendu, etc.
Ces travaux ont largement inspiré la loi Pacte entrée en vigueur en 2019. En effet, cette dernière offre la possibilité aux entreprises volontaires de se doter d’une raison d’être et de l’intégrer dans leurs statuts. Cela représente d’autant plus une avancée que tout manquement à cette raison d’être pourrait être sanctionné par les clients et les investisseurs. Il s’agit en effet d’un engagement visible et intimement lié à la stratégie de l’entreprise.
Pour les entreprises les plus engagées, la loi Pacte permet l’adoption du statut de société à mission, ce qui représente une petite révolution. En effet, les sociétés commerciales qui le souhaitent peuvent poursuivre dans le cadre de leur activité « un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux » (article L. 210-10 du Code de commerce). Ce statut doit être déclaré au greffe du tribunal du commerce. Dès lors, la raison d’être doit figurer dans les statuts avec une formulation claire de la mission, l’impact social, sociétal ou environnemental attendu, les objectifs chiffrés et le dispositif de reporting. La gouvernance de l’entreprise doit prendre en compte cette nouvelle mission au sein de l’organe de contrôle principal, soit en créant un comité de mission distinct.
L’institutionnalisation de l’hybridation de l’entreprise (cohabitation de l’intérêt général et les intérêts des actionnaires) est donc actée par la loi Pacte même s’il reste encore des étapes à franchir. Une telle hybridation de l’objet social de l’entreprise ne peut donner pleinement satisfaction sans une réforme de la comptabilité qui reste l’instrument central de la gouvernance d’entreprise. L’objectif est d’aller plus fondamentalement vers « une gouvernance écologique et humaine » comme l’appelle notamment de ses vœux le professeur émérite de l’université Paris Dauphine : Jacques Richard. Ce dernier propose notamment dans ses travaux un alternatif à la comptabilité standard : la comptabilité adaptée au renouvellement de l’environnement (CARE). L’objectif d’une telle innovation est d’étendre l’expression du bilan et du compte de résultat classiques en positionnant les êtres humains et les entités environnementales employés par l’entreprise comme un passif et non plus un actif ou une charge.
Ibrahima FALL, Directeur au sein d’Eurogroup Consulting et membre du Laboratoire d’innovation managériale de la même institution & Docteur en management